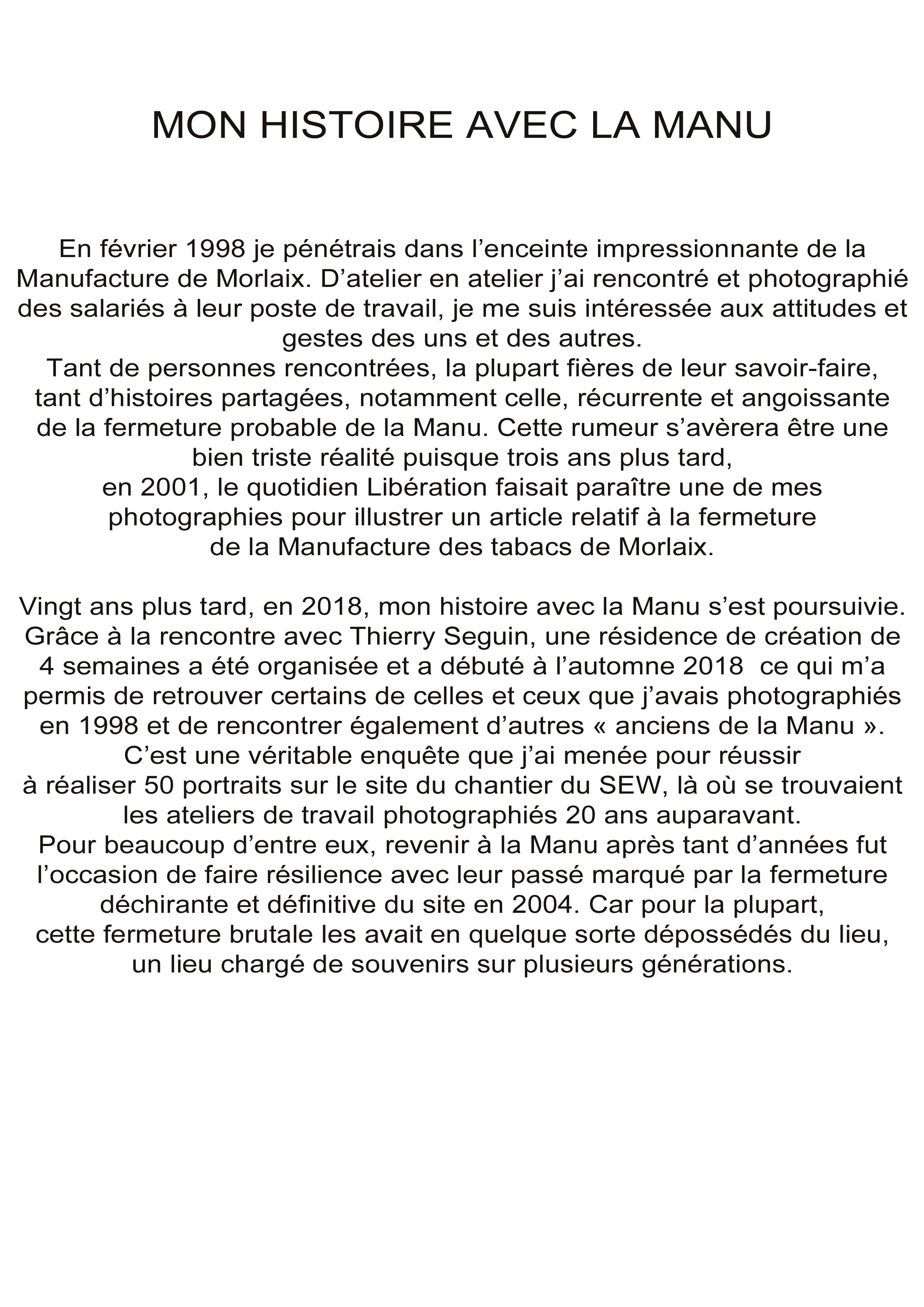Ceux qui réparent
Lorsque l’association dijonnaise “ Juste une Mise au Point ” m’a proposé une résidence artistique sur le territoire de Dijon Métropole, j’ai spontanément émis le souhait de photographier dans une usine afin de poursuivre mon travail commencé il y a 20 ans sur le monde ouvrier. Un travail documentaire qui avec le temps a pris quelques libertés de forme tout en gardant sa ligne fondatrice qui est de photographier l’humain.
Avant de visiter le site Protéor de Seurre, j’étais loin d’imaginer l’impact visuel que sa production de prothèses et orthèses pouvait provoquer sur tout visiteur curieux ou non de l’univers industriel.
Entrer chez Protéor ce n’est pas entrer dans une usine quelconque car c’est là qu’on y voit des prothèses de jambes rangées dans des caisses en attendant d’être réparées, une imposante machine à fabriquer des pieds, un atelier plâtre aux airs d’atelier beaux-arts, des corsets petits et grands posés sur des étagères…
Le visuel surréaliste et déroutant de la production, alliant une pratique très artisanale et une technologie de pointe ne m’a pourtant pas distraite de l’essentiel.
Mon essentiel étant Ceux qui œuvrent derrière leurs postes, Ceux qui fabriquent, Ceux qui réparent, Ceux qui redonnent mobilité aux corps d’individus blessés ou malades. Ceux qui sont passionnés, soucieux du travail bien fait et fiers de la portée humaine de celui-ci.
Je pense à Stella qui m’a dit : “Quand je travaille sur un plâtre d’enfant, je lui parle”, je me souviens aussi d’Alex me confiant : “Je pars du principe que j’aime aider les gens, grâce à mon travail les gens iront mieux”.
Au fil des rencontres et des échanges j’ai retrouvé la fierté, les codes, les savoir-faire d’une classe ouvrière en perte d’identité et de reconnaissance.
Autant de rencontres, de visages et d’histoires uniques, autant de postes de travail différents, certains peut-être plus valorisants que d’autres car plus artisanaux qu’industriels.
Durant ces trois semaines de l‘année 2019, j’ai approché 65 salariés sur un effectif de 165 personnes.
J’ai réalisé le portrait de ces femmes et de ces hommes pour témoigner qu’ils sont précieux, qu’ils ne l’oublient pas et qu’on ne les oublie pas.
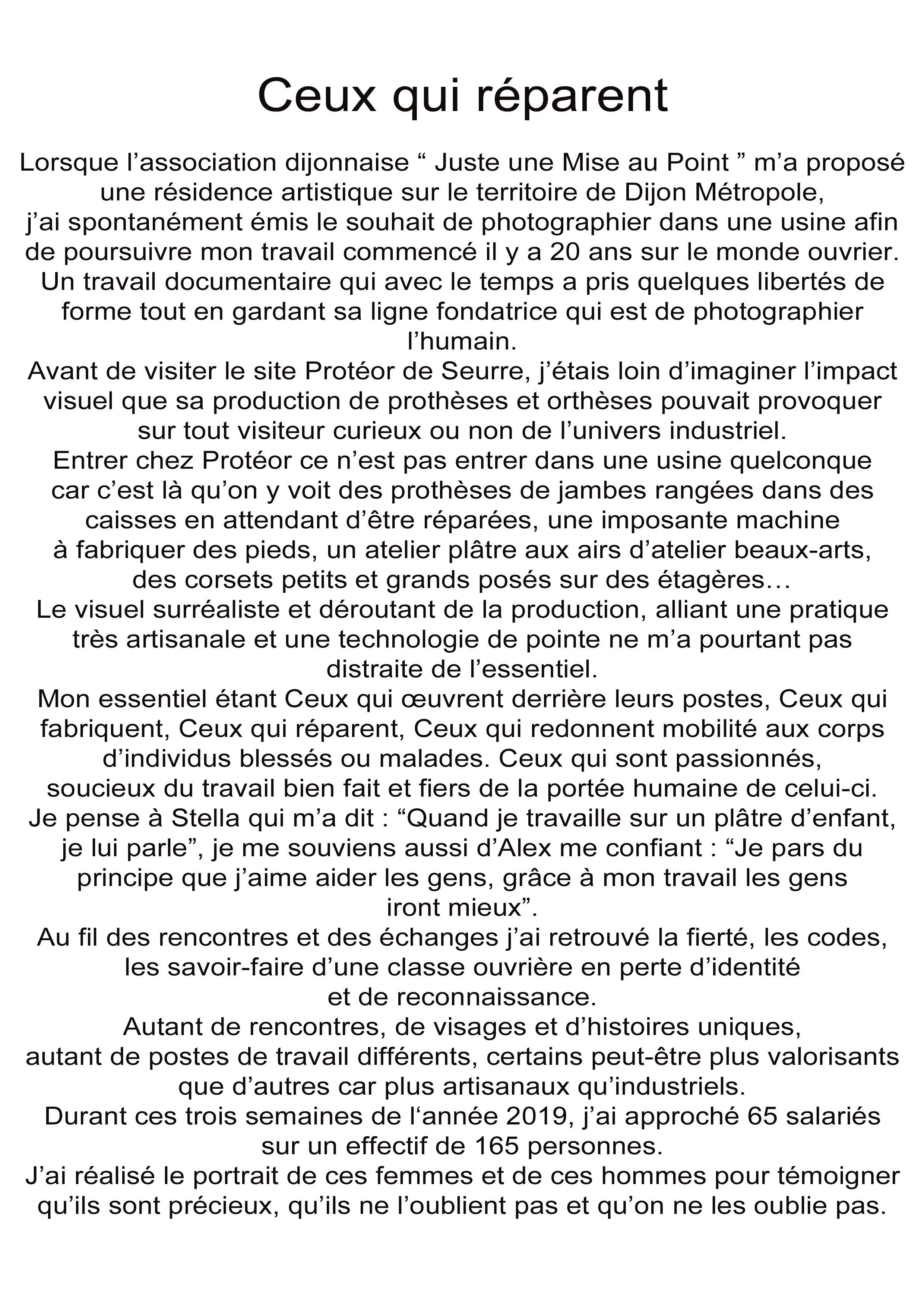

































Mon histoire avec la Manu
MON HISTOIRE AVEC LA MANU
En 1997 j’ai débuté ma série « usines » qui consistait à documenter en noir et blanc différents sites industriels sur le territoire français.
Ainsi, en février 1998 je pénétrais dans l’enceinte impressionnante de la Manufacture de Morlaix. D’atelier en atelier j’ai rencontré et photographié des salariés à leur poste de travail, je me suis intéressée aux attitudes et gestes des uns et des autres.
Je me souviens de Jacqueline Lejeune à « l’atelier poupée » qui travaillait depuis 29 ans à la Manu et qui m’avouait, avec enthousiasme, que « travailler à la manu c’était presque le paradis ! ».
Je me souviens de la rencontre avec Maryse Troadec à « l’atelier du tabac à chiquer » qui officiait depuis 1976 à ce poste et qui « pour rien au monde n’aurait voulu changer de poste… », de Jeanine Salaün, au capage manuel, qui aimait travailler en écoutant la radio dans un casque, de Michel Queguiner pour lequel son métier à la Manu était une histoire de famille car son père et son grand-père l’y avaient précédé, une histoire de famille parmi beaucoup d’autres à la Manu.
Tant de personnes rencontrées, la plupart fières de leur savoir-faire, tant d’histoires partagées, notamment celle, récurrente et angoissante de la fermeture probable de la Manu.
Cette rumeur s’avèrera être une bien triste réalité puisque trois ans plus tard, en 2001,
le quotidien Libération faisait paraître une de mes photographies pour illustrer un article relatif à la fermeture de la Manufacture des tabacs de Morlaix.
20 ans plus tard, en 2018, mon histoire avec la Manu s’est poursuivie.
Grâce à la rencontre avec Thierry Seguin, une résidence de création de 4 semaines a été organisée et a débuté à l’automne 2018 ce qui m’a permis de retrouver certains de celles et ceux que j’avais photographiés en 1998 et de rencontrer également d’autres « anciens de la Manu ».
C’est une véritable enquête que j’ai menée pour réussir à réaliser 50 portraits sur le site du chantier du SEW, là où se trouvaient les ateliers de travail photographiés 20 ans auparavant.
Pour beaucoup d’entre eux, revenir à la Manu après tant d’années fut l’occasion de faire résilience avec leur passé marqué par la fermeture déchirante et définitive du site en 2004. Car pour la plupart, cette fermeture brutale les avait en quelque sorte dépossédés du lieu, un lieu chargé de souvenirs sur plusieurs générations.
Vivre cette résidence a été forte en émotions et a pris tout son sens dans ma volonté de rendre hommage à celles et ceux qui ont travaillé à la Manu et marqué de leur empreinte la mémoire ouvrière de Morlaix.
Pendant 260 ans, le beau et imposant bâtiment de la Manufacture a abrité toute une production liée au tabac et après de longues années d’abandon, la Manufacture s’est réveillée pour devenir une plateforme culturelle et bientôt un espace des sciences, qui garderont à jamais les traces des femmes et des hommes qui y ont donné une partie de leur vie.